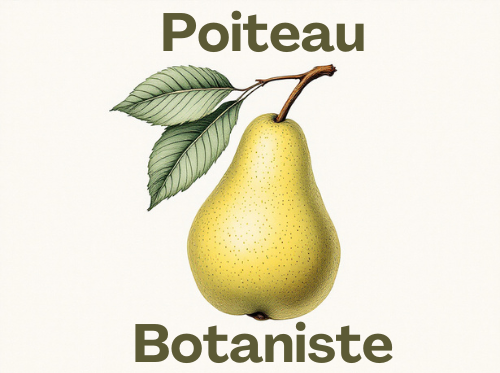Introduction
La Guyane française, terre de biodiversité et d’exploration scientifique, a été le terrain d’une mission botanique ambitieuse au début du XIXe siècle. Pierre-Antoine Poiteau (1766-1854), botaniste du roi et directeur des cultures aux habitations royales, a entrepris un voyage en Guyane entre 1819 et 1821. Son objectif ? Recueillir des espèces végétales, développer des cultures utiles et enrichir la science botanique française.
Préparatifs du Voyage
En 1818, le ministre de la Marine initie un projet visant à étendre en Guyane la culture de plantes utiles issues des colonies françaises et du monde entier. Ce projet requiert l’expertise d’un botaniste capable de diriger les recherches et les plantations.
- Le ministre de l’Intérieur sollicite les administrateurs du Jardin du Roi pour désigner un scientifique compétent.
- Une rémunération de 6000 francs est allouée au botaniste, avec un budget dédié aux recherches et expérimentations.
- Poiteau, enthousiasmé par cette mission, postule à ce poste et sa candidature est retenue.
- Poiteau prépare alors départ, et pour cela, il demande à ce que son fils aîné soit placé dans un des collèges royaux, et il sollicite une place pour son fils cadet à l’École des Arts et Métiers de Châlons.
- Il embarque alors à la fin de l’hiver 1819 avec sa femme, ses 3 autres enfants et un autre membre de sa famille.
Déroulement de la mission en Guyane
Après un long voyage transatlantique, Poiteau débarque en Guyane et est placé sous l’autorité du directeur des domaines. Cependant, des tensions naissent rapidement :
- Poiteau se voit refuser l’assistance de travailleurs locaux pour ses explorations.
- Il doit effectuer seul ses recherches, limité à un périmètre restreint.
- Une exception survient lorsqu’il intègre une commission d’exploration sur le fleuve Mana.
- Malgré ces obstacles, il parvient à collecter une impressionnante variété de plantes, envoyant en France une des plus riches collections jamais réunies.
Explorations et Découvertes
Le moment fort de l’expédition est la mission d’exploration du fleuve Mana, dirigée par Catineau Laroche, visant à évaluer la faisabilité d’une colonisation agricole européenne dans cette région :
- La mission, composée de guides amérindiens Galibis et de 50 soldats, pénètre l’embouchure du fleuve le 5 novembre 1820.
- Poiteau et cinq compagnons s’aventurent à pied à travers la forêt en direction du fleuve Maroni.
- Après 166 km de marche dans des conditions extrêmes, ils se perdent et rebroussent chemin sept jours plus tard, épuisés.
Malgré ces difficultés, la mission est un succès sur le plan botanique. Poiteau acclimate 200 palmiers sagoutiers et recense une importante variété de plantes.
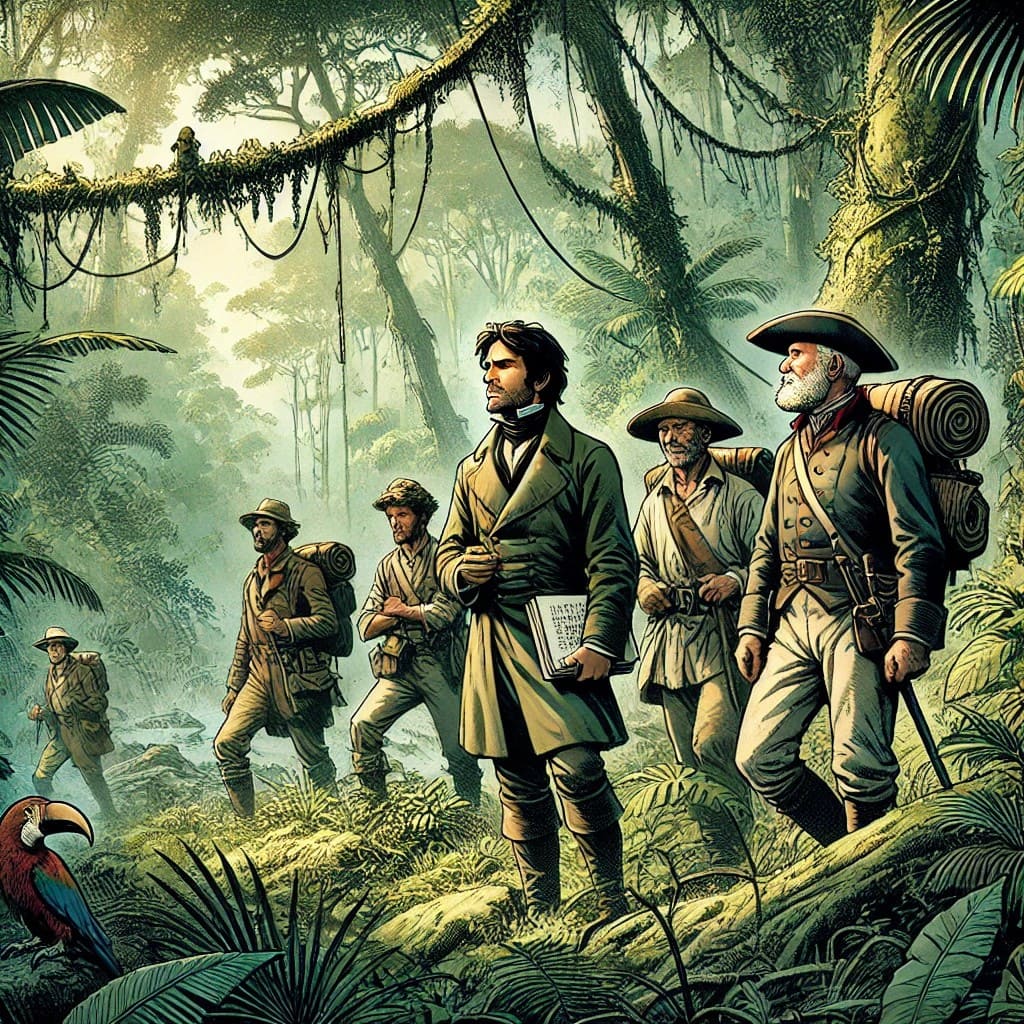
Poiteau et 5 compagnons en direction du fleuve Maroni (Illustration)
Obstacles administratifs et conflits
L’administration coloniale s’avère un frein majeur aux ambitions scientifiques de Poiteau :
- Le directeur des domaines lui impose des restrictions injustifiées.
- Les tensions atteignent un point critique en 1821, aboutissant à son expulsion.
- Le gouverneur ordonne son retour en France.
Retour en France et conséquences
Poiteau quitte la Guyane en juin 1821 à bord de la Durance et arrive au Havre le 19 juillet. Il termine son voyage en vapeur pour retourner à Paris le 3 août 1821.
Son retour est marqué par des démarches pour obtenir reconnaissance et indemnisations :
- Le nouveau ministre de la Marine supprime les deux places de Directeur des cultures et de Directeur des Domaines en Guyane.
- Poiteau touche une indemnité partielle jusqu’en novembre.
- L’administration lui reproche d’avoir emporté un catalogue du Jardin Royal des Plantes de Cayenne, ce qu’il dément.
- Il revendique le remboursement de ses frais de voyage, mais se voit répondre que le Jardin du Roi devrait s’en charger.
- Au final, ses collections botaniques intègrent les herbiers des Richard, du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, et de l’herbier Delessert à Genève.
Un Héritage Botanique Précieux
Malgré les embûches, la mission de Poiteau a laissé une empreinte durable dans l’histoire de la botanique :
- En 1825, il propose une méthode innovante de greffe du giroflier sur des espèces locales.
- Son travail contribue à l’enrichissement des connaissances sur la flore guyanaise.
- Ses collections sont encore aujourd’hui une ressource essentielle pour les chercheurs et botanistes.
Conclusion
L’expédition de Pierre-Antoine Poiteau en Guyane illustre les défis des explorations scientifiques du XIXe siècle. Entre ambition scientifique et obstacles bureaucratiques, son voyage révèle la difficulté de concilier recherche et administration coloniale. Pourtant, ses découvertes et collections demeurent une contribution inestimable à la botanique tropicale.
Hasard de l’Histoire à propos du bateau La Durance
Un détail singulier vient clore l’histoire du navire La Durance, qui avait servi au transport des naturalistes et scientifiques lors de l’expédition en Guyane.
Après avoir été le témoin de nombreuses missions d’exploration, naviguant vers les Antilles et la Réunion, son destin prit une tournure inattendue.
En 1855, renvoyée en Guyane pour l’ouverture du bagne, La Durance fut rebaptisée Le Gardien et transformée en ponton carcéral.
Elle devint ainsi le premier pénitencier flottant de la colonie, hébergeant les détenus envoyés purger leur peine sur ce territoire inhospitalier.
Une fin ironique et bien éloignée de ses premières traversées dédiées à la science et à la découverte.